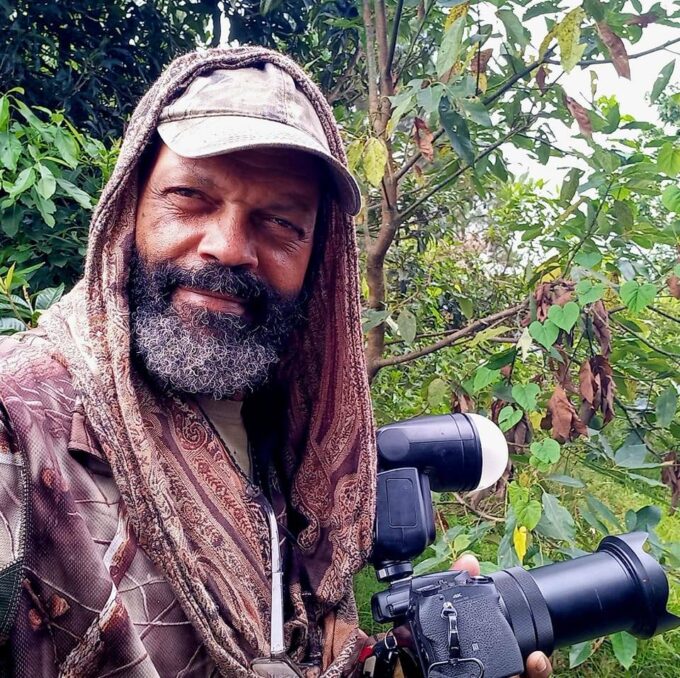Haïti pratique l’exportation de l’anguille depuis près de 20 ans. Dans ce contexte, l’ex-ministre de l’Environnement, Jean Vilemont Hilaire, (intervenant sur les ondes de Radio Magik 9, le lundi 27 janvier 2025), estime que cette filière représente une opportunité, non seulement pour les personnes déjà impliquées dans ce secteur, mais aussi pour le pays. Il a souligné que : « L’État haïtien pourrait saisir cette occasion pour régulariser le commerce de l’anguille, afin de le retirer du trafic illicite, ce qui contribuerait, entre autres, à réduire les enjeux sécuritaires. »
L’anguille, une espèce résiliente mais menacée
« L’anguille n’est pas une couleuvre, c’est un poisson comptant près de 19 espèces. Existant depuis environ 70 millions d’années avant l’homme, elle peut vivre entre 3 et 40 ans. L’espèce d’anguille exploitée en Haïti est appelée Anguilla austrata. Ce poisson se reproduit en mer et grandit près des embouchures, dans des eaux douces et salées. « Sa capacité d’adaptation à différents environnements en fait une espèce résiliente, bien que de plus en plus vulnérable face aux menaces environnementales », a expliqué l’environnementaliste Vilmont Hilaire lors de l’émission Panel Magik.
Les zones de pêche les plus connues en Haïti se situent aux pieds des grands bassins versants :
- Nord : Cap-Haïtien, Bas-Limbé, Port Margot, Borgne, Limonade, Camp Louise, Labadee ;
- Nord-Est : Caracol ;
- Artibonite : Saint-Marc ;
- Nord-Ouest ;
- Sud-Est : Jacmel ;
- Grande-Anse : Jérémie, commune des Roseaux ;
- Nippes : Kawouk, Petite-Rivière de Nippes.
Contrairement à l’espèce d’anguille en Europe, qui est en voie d’extinction, Anguilla austrata n’a pas encore atteint ce statut. Cependant, elle reste menacée. La dégradation de l’environnement pourrait conduire à sa disparition. La majorité des zones où cette espèce vit et se reproduit se trouve au pied des bassins versants, une situation qui représente un danger imminent pour sa reproduction et sa survie.
D’autres facteurs aggravent cette menace : la déforestation, la pollution des eaux, la surpêche et les changements climatiques. De plus, la surexploitation de cette espèce avec des méthodes et des matériels non conformes aux normes internationales met en péril toute la filière.
Une filière lucrative, mais inégalement partagée
En termes d’exploitation, Haïti a une capacité d’exportation de plus de 800 tonnes métriques. Le prix du kilo varie entre 700 et 5000 dollars américains, selon les tailles et les demandes. Certaines années, les prix CIF (coût, assurance, fret) pour l’exportation de civelles (bébés anguilles) peuvent grimper jusqu’à 5000-6000 $ US le kilo, a indiqué un entrepreneur taïwanais impliqué dans ce commerce. Cela reflète la demande croissante de ce poisson sur les marchés internationaux.
Le Japon représente le principal marché des civelles en provenance d’Haïti. Cependant, les exportateurs haïtiens vendent généralement leurs civelles à des acheteurs hongkongais qui les élèvent dans des fermes avant de les revendre à des prix très élevés, une fois adultes, aux consommateurs japonais.
Un regroupement d’une vingtaine d’individus détient actuellement l’exclusivité de l’exportation des anguilles en Haïti. Ce « petit groupe » fixe le prix des produits, ce qui désavantage l’ensemble de la chaîne d’exploitation.
Par ailleurs, plusieurs acteurs soupçonnent ce secteur de blanchir de l’argent, notamment issu du trafic de drogue et d’organes. Ces accusations ont été portées par la directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Waly. Lors d’une réunion d’information sur Haïti au Conseil de sécurité de l’ONU, le mercredi 22 janvier 2025, elle a alerté sur « des indications montrant que des acteurs politiques et économiques en Haïti utilisent l’industrie de l’anguille pour blanchir les profits du trafic de drogue ».
Solutions proposées
L’écologiste Vilmont Hilaire propose plusieurs mesures pour assainir cette filière :
- Publier la liste des personnalités et entreprises ayant accès à l’exploitation de cette ressource, afin de rendre transparent ce secteur ;
- Protéger les sites où évoluent ces espèces, en luttant contre les menaces qui pèsent sur leur habitat ;
- Régulariser et encadrer la gestion de cette ressource sous le contrôle du ministère de l’Environnement et du ministère du Commerce ;
- Interdire l’exploitation des civelles, malgré le poids des intérêts financiers et politiques derrière ce commerce.
Selon lui, « l’État haïtien doit établir des règles claires et garantir leur application pour préserver cette ressource au profit de l’intérêt général ».
« Un petit clan ne doit pas être le seul à bénéficier des avantages. Tous les citoyens devraient pouvoir profiter de cette richesse nationale. », conclut-il.
Jean Rony Poito PETIT FRÈRE