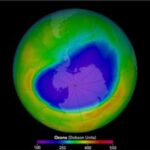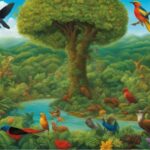Haiti, pays insulaire situé en mer des Caraïbes, est l’une des nations les plus vulnérables au monde aux catastrophes naturelles. Les ouragans, les inondations,les tremblements de terre et les sécheresses sont des risques naturels fréquents qui peuvent causer des dommages importants.
De surcroît, la déforestation, la pollution et la perte de biodiversité aggravent les risques environnementaux et sanitaires.
Des problèmes de santé comme le choléra et d’autres maladies infectieuses sont également fréquents. Tous ceux-ci constituent une nuisance pour la population, entraînant des conséquences néfastes sur la santé humaine et l’environnement.
Risques environnementaux
Catastrophes naturelles :
En raison de sa situation géographique, Haïti est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Les ouragans, les inondations, les tremblements de terre et les sécheresses sont fréquents. Ces événements climatiques et géologiques provoquent des pertes humaines et d’importants dégâts matériels. La déforestation, qui aggrave les effets des inondations et des coulées de boue, et la topographie du pays, avec ses montagnes et ses rivières convergeant vers la côte, accentuent cette vulnérabilité.
Déforestation et dégradation des sols :
La déforestation, exacerbée par la production de charbon de bois, entraîne des conséquences désastreuses. La destruction des forêts provoque une perte de biodiversité, car de nombreuses espèces animales et végétales perdent leur habitat et leur source de nourriture. De plus, la dégradation des sols s’aggrave, les rendant plus vulnérables à l’érosion et à la désertification. Ces phénomènes affectent non seulement l’environnement, mais aussi les communautés locales qui dépendent des forêts pour leur subsistance et leur bien-être.
Pollution :
Les problèmes de pollution de l’eau, de l’air et des sols sont souvent liés aux activités industrielles et à la manière dont les infrastructures sont gérées. Ces activités peuvent rejeter des substances nocives dans l’environnement, entraînant une contamination des ressources en eau, de l’atmosphère et du sol. De mauvaises pratiques de gestion des déchets, des fuites d’eaux usées industrielles, et l’utilisation intensive de produits chimiques dans l’agriculture contribuent également à cette dégradation.
Érosion côtière :
L’intensification de l’érosion côtière, exacerbée par le changement climatique, représente une menace sérieuse pour les zones littorales et les écosystèmes marins. L’élévation du niveau de la mer, les tempêtes plus fréquentes et plus intenses, ainsi que l’augmentation de l’érosion des sols due à des précipitations plus importantes, mettent en péril les infrastructures, les habitations et les moyens de subsistance des populations vivant à proximité du littoral.
Risques sanitaires
Maladies infectieuses :
Les maladies telles que le choléra, la dengue, le chikungunya et le Zika, toutes transmises par des moustiques, peuvent entraîner des complications graves, voire la mort. Ces maladies virales, bien que souvent présentes dans les régions tropicales et subtropicales, peuvent également se propager dans d’autres zones géographiques en raison de la mobilité des personnes et de la présence de moustiques vecteurs. Les symptômes peuvent varier, mais incluent souvent fièvre, douleurs articulaires et musculaires, maux de tête, et éruptions cutanées.
Conditions de logement insalubres :
Les conditions de logement précaires, telles que la surpopulation, l’absence d’eau potable, constituent des facteurs de risque majeurs pour la santé publique. Ces facteurs favorisent la propagation de maladies et augmentent la vulnérabilité aux problèmes sanitaires. Des logements surpeuplés, où plusieurs familles ou individus partagent un espace restreint, facilitent la transmission de maladies infectieuses. Les logements vétustes, avec des problèmes d’humidité, de moisissures et d’infiltrations, aggravent les maladies respiratoires et les allergies, surtout chez les enfants. De plus, le manque d’accès à l’eau potable crée un risque accru de maladies d’origine hydrique et compromet l’hygiène de base. En résumé, l’état du logement a un impact direct et significatif sur la santé des occupants, exacerbant les risques sanitaires et contribuant à la précarité.
Consommation de drogues illicites :
La consommation de drogues illicites peut entraîner des problèmes de santé graves, notamment des infections, des maladies chroniques et des troubles psychiatriques.
Face aux impacts des risques environnementaux et sanitaires sur la santé humaine et l’environnement, il y a urgence d’agir. L’Etat haïtien et les instances concernées doivent poser des actions menant à l’éducation des gens, la réduction des émissions polluantes, la promotion des pratiques agricoles durables, à l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, à la surveillance des maladies liées à l’environnement.
Pour conclure, Haïti est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. Plus de 93 % de sa surface et plus de 96 % de sa population sont exposées aux catastrophes naturelles risque d’au moins deux aléas (GFDRR/ Groupe de Développement et de Gestion des Risques de Catastrophe et Banque mondiale).
La déforestation, la pollution, les catastrophes naturelles et les maladies infectieuses constituent des défis majeurs pour le pays. Les efforts de prévention et d’adaptation sont essentiels pour améliorer la résilience de la population et garantir un avenir durable.
N.B : La photo de couverture illustre deux types de risques liés aux déchets solides. Premièrement, les déchets jetés par les habitants de la zone, souvent en raison du manque de formation et de l’absence de poubelles, polluent l’environnement (risques environnementaux). Deuxièmement, la personne qui trie ces déchets à Maïs-Gâté à Port-au-Prince, dans l’espoir de trouver des objets à revendre expose sa santé, aussi la santé des habitants du quartier est menacée par la pollution émanant de ce tas d’ordures (risques sanitaires).
Photo : Dieugo André
Jimmy DELISCA
Ingénieur-agronome, écologiste
Mots clés
•