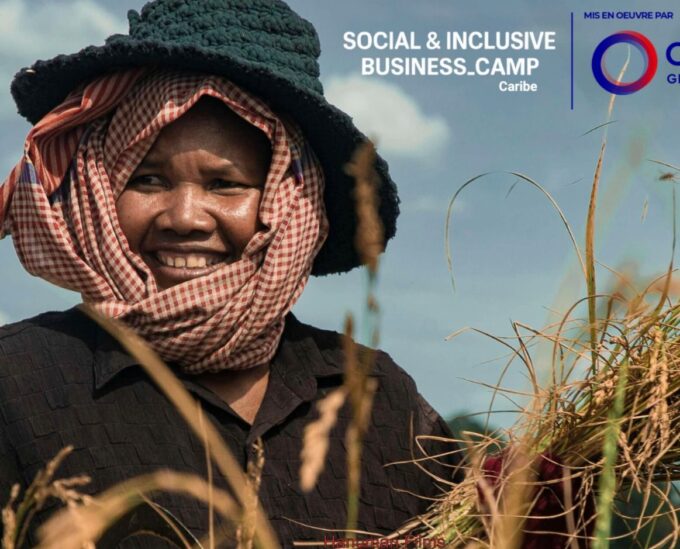Alors que la troisième conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC3) touche à sa fin, les États insulaires en développement (PEID) haussent le ton pour peser sur la déclaration politique finale.
Portés par une vulnérabilité bien connue, mais aussi par une volonté croissante de leadership, ces États affirment qu’il ne saurait y avoir de véritable gouvernance de l’océan sans leur pleine implication.
Réunis au sein de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), ils ont mené une offensive diplomatique discrète mais efficace, afin que leurs priorités, notamment la lutte contre l’élévation du niveau de la mer, la protection des ressources marines et le financement climatique, soient dûment prises en compte dans le Plan d’action de Nice pour l’océan, attendu ce vendredi.
Le texte final, intitulé Notre océan, notre avenir : unis pour une action urgente, doit acter des engagements volontaires pour accélérer la protection des écosystèmes marins, lutter contre la pollution plastique et développer une économie bleue équitable. Il met en lumière l’interdépendance entre l’océan, le climat et la biodiversité, un triptyque vital pour les PEID.
« Une grande partie de notre patrimoine, de notre culture et de notre économie vient de l’océan. « Il ne peut y avoir de déclaration sur l’océan sans les PEID », a affirmé avec force Safiya Sawney, ambassadrice de la Grenade pour le climat, lors d’une prise de parole jeudi dernier. Selon elle, ces États ne veulent plus seulement être des figures de la vulnérabilité, mais des acteurs de solutions.

La mention dans la déclaration finale de la Déclaration d’Antigua-et-Barbuda pour les PEID, adoptée en mai 2024, constitue une avancée importante. Elle reflète la reconnaissance d’un agenda spécifique porté par ces pays souvent oubliés des grandes dynamiques de financement.
Autre moment fort du sommet : le lancement de l’initiative Actioning Blue : Vision 30×30 pour les Caraïbes, portée par douze gouvernements caribéens. Objectif : atteindre 30 % d’aires marines protégées d’ici 2030, en ligne avec le cadre mondial sur la biodiversité adopté à Montréal en 2022.
« La région est contrainte en matière de capacités, mais nous voulons inverser la tendance », a souligné Mme Sawney. « Nous voulons faire comprendre à nos partenaires que nous sommes prêts à assumer la mise en œuvre. »
L’un des points critiques soulevés par les PEID reste le financement. L’objectif de développement durable n°14, qui vise la conservation et l’exploitation durable des océans, reste l’un des moins dotés. Les insulaires plaident pour une solidarité différenciée, estimant que certains pays doivent faire davantage pour compenser les inégalités de capacité et de responsabilité.
« Mais il y a une chose avec laquelle nous ne pouvons pas transiger, c’est la nature », a rappelé l’ambassadrice grenadienne.
Alors que les regards se tournent vers l’adoption formelle de la déclaration, les PEID préviennent déjà : ce sommet n’est qu’un début. « Le vrai travail commence après », conclut Mme Sawney, bien décidée à faire de l’océan un champ d’action, et non de résignation.
Jean Rony Poito PETIT FRÈRE