La montée des inondations, les ravages de l’érosion et l’accélération de la déforestation rappellent chaque année aux Haïtiens la fragilité de leur territoire. Pourtant, malgré l’urgence, l’environnement reste à la marge des priorités publiques. C’est autour de ce paradoxe qu’Amos François, fondateur du Cabinet AFC et professeur à l’Université d’État d’Haïti, a pris la parole à l’émission HaïtiClimat, le jeudi 25 septembre 2025. Interrogé sur le thème « L’environnement dans les politiques publiques haïtiennes : mythe ou réalité ? », il a dressé un constat sévère : l’absence de volonté politique et de mobilisation citoyenne mine toute perspective de changement durable.
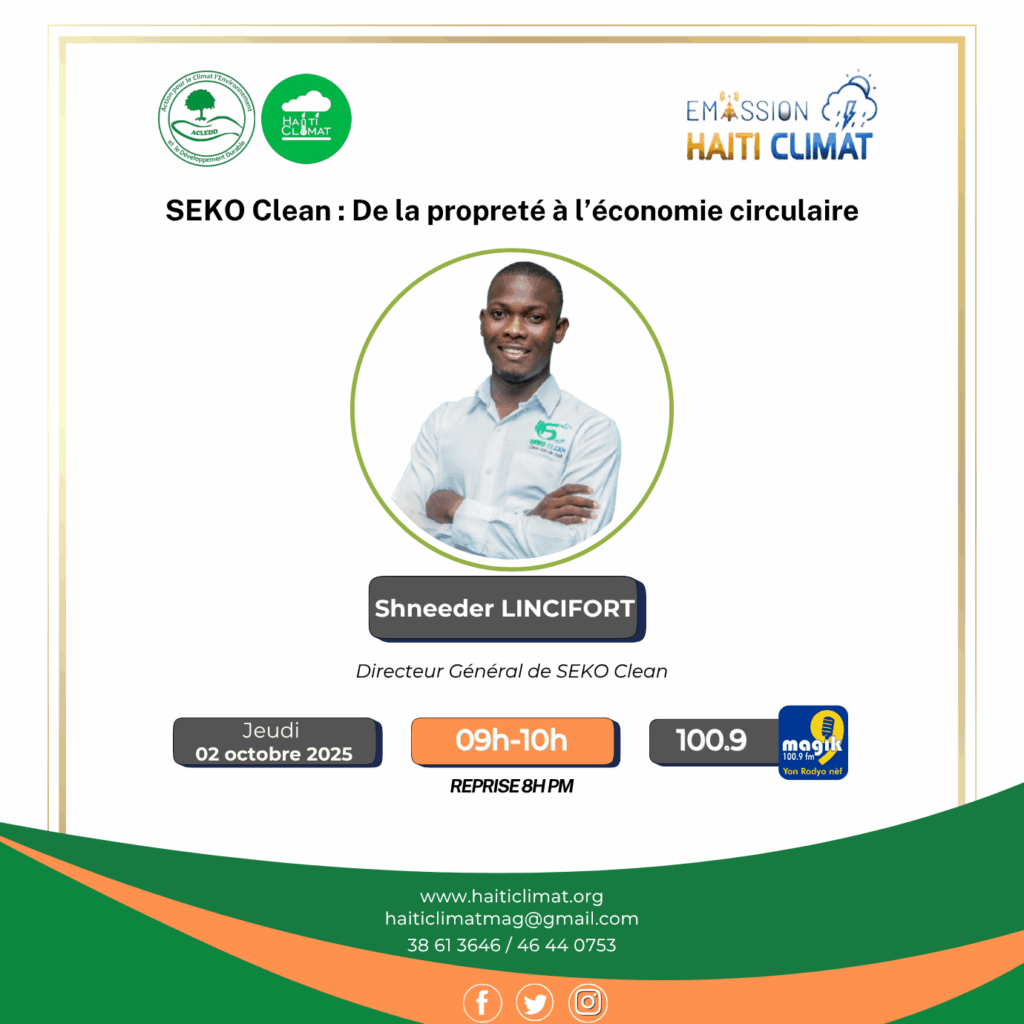
Pour le professeur, la crise environnementale actuelle plonge ses racines dans le passé du pays. « On ne peut pas penser l’environnement aujourd’hui sans penser à notre passé colonial, où nous avons développé un rapport plus destructeur que constructif, profondément ancré dans l’imaginaire haïtien. D’où la dimension historique », explique-t-il.
Au-delà de l’histoire, François estime que l’approche dominante demeure insuffisante. « La protection de l’environnement ne peut se limiter à une perspective économique, car cette approche anthropocentrique s’avère déficiente. Il est essentiel de reconnaître sa valeur intrinsèque et de le préserver en conséquence », insiste-t-il.
Un constat qui s’accompagne d’une critique de l’écart entre les textes de loi et leur application réelle. « Tant que nous protégeons l’environnement uniquement pour qu’il nous rende des services, nous ne faisons que créer des lois visant à accélérer la croissance économique, sans jamais parvenir à réduire l’écart entre ces lois et leur mise en œuvre. Il existe donc un déficit de perception par rapport à l’environnement. »
Des politiques adaptées au contexte haïtien
Le professeur plaide également pour une réflexion ancrée dans la réalité du pays. « Il faut comprendre la société haïtienne de manière plus approfondie afin de faire émerger des politiques publiques autonomes, locales, capables d’intégrer les ancrages culturels haïtiens ainsi que le rapport que le peuple entretient avec la terre », soutient-il.
Si la mise en place de politiques cohérentes relève d’abord des autorités publiques, la pression citoyenne reste indispensable selon lui. « Les acteurs de la société civile doivent faire pression sur l’État pour qu’il assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement et des changements climatiques, car c’est à l’État de donner le ton », affirme François.
Néanmoins il regrette la faible implication des jeunes et des organisations locales dans la cause climatique. « Il n’existe pas véritablement de volonté politique ni de conscience citoyenne en matière d’environnement et de changements climatiques : combien de jeunes, combien de groupes sont réellement mobilisés pour le climat ? », questionne-t-il, appelant à une mobilisation plus large et durable.
Esther Kimberly BAZILE








